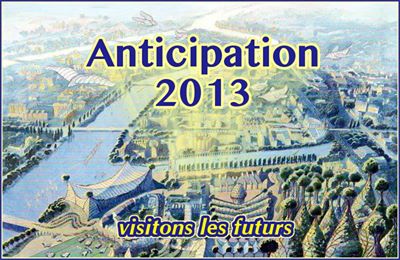Au fil des pages d’une longue lettre, une très vieille dame revient sur quelques épisodes marquants de sa jeunesse à Ha Rebin, Mandchourie ; à une époque où les gens se rencontraient encore facilement en personne, où l’on croisait des nord européens presque purs et peut-être même des papillons, où le sol était encore habité… plus pour longtemps. Une vieille dame digne sans doute, cultivée pour le moins, mais qui promet à son correspondant “de l’enfant mort, de la femme étranglée, de l’homme assassiné et de la veuve inconsolable, des cadavres en morceaux, divers poisons, d’horribles trafics d’humains, une épidémie sanglante, des spectres et des sorcières, plus une quête sans espoir, une putain, deux guerriers magnifiques dont un démon nymphomane et une… non, deux belles amitiés brisées par un sort funeste, comme si le sort pouvait être autre chose.“
Que dire de plus sinon que ce roman porte exactement tout cela et plus encore, dans un décor dantesque qui ne ressemble que trop à notre futur, terre desséchée, eau empoisonnée, animaux-souvenirs, ghettos souterrains et privilégiés réfugiés dans des tours de verre et d’acier se haïssant et trafiquant ensemble pâte d’oxygène et aliments reconstitués. Cela fait un peu froid dans le dos, oui, d’autant que pendant ma lecture a eu lieu la fameuse alerte à la pollution de Ha Rebin, la Ha Rebin d’aujourd’hui – sachant que pour que la Chine parle d’alerte à la pollution, cela a du être quelque chose.
Catherine Dufour s’inspirant – pour la forme – des Mémoires d’Hadrien trace le portrait foisonnant d’un monde disparu pratiquement sous ses yeux, à la fois passé et futur, où se pose la question sans cesse renouvelée de la longévité – et plus si affinité. Mais pour quoi faire, à quel prix et dans quel but ? “les plus de cent ans possèdent le pouvoir (…) et qu’en font-ils ? Après tout qu’attendre de gens qui, au bout de cent années d’existence, ne sont morts ni d’amour, ni de dégoût, ni d’épuisement ? Un peu de sagesse ? J’en cherche les effets autour de moi et je ne vois rien. (…) Nous qui avons le temps, la connaissance et le pouvoir, nous ne savons que durer, nous n’avons appris qu’à nous survivre.”
Pour couronner le tout, ce roman est écrit dans une langue limpide, incisive et généreuse qui m’a ravie. Je connaissais la réputation “burlesque” de l’auteure et de sa série Quand les dieux buvaient – elle livre ici un roman d’anticipation puissant et chatoyant de noirceur. Beau comme le jaune souffre brillant d’un ciel toxique !
Le goût de l’immortalité – Catherine Dufour – 2005 – Mnémos
PS : Du coup j’ai envie de relire les mémoire d’Hadrien moi…
PPS : et en plus je viens de gagner chez le Traqueur un autre roman de l’auteure se déroulant dans le même univers, elle est pas belle la vie ?
Lu dans le cadre du challenge anticipation de Julie des magnolias…