 Il était une fois une famille de l’élite parisienne, lui journaliste célèbre et influent absorbé par son aura ; elle, intellectuelle engagée et essayiste connue de 27 ans sa cadette ; leur fil, Alexandre – 21 ans, surdoué, polytechnicien et étudiant à Stanford. Une famille idéale selon certains, mais évidemment fissurée de partout qui explose quand, dans le contexte des agressions de Cologne en 2016 et du #metoo triomphant sur les réseaux sociaux, le fils prodigue est accusé du viol le plus sordide qui soit, celui qui s’ignore…
Il était une fois une famille de l’élite parisienne, lui journaliste célèbre et influent absorbé par son aura ; elle, intellectuelle engagée et essayiste connue de 27 ans sa cadette ; leur fil, Alexandre – 21 ans, surdoué, polytechnicien et étudiant à Stanford. Une famille idéale selon certains, mais évidemment fissurée de partout qui explose quand, dans le contexte des agressions de Cologne en 2016 et du #metoo triomphant sur les réseaux sociaux, le fils prodigue est accusé du viol le plus sordide qui soit, celui qui s’ignore…
Paradoxalement j’ai beaucoup aimé ce livre. Oui paradoxalement car au départ je me suis demandé sur quelle planète vivaient ces gens. Pas la mienne assurément, peut-être la Saturne de Bénabar après tout. Que qui que ce soit puisse voir cette famille comme idéale – même avant d’entrer dans la tête des protagonistes – me semble quand même fort de café, à moins de prendre le clinquant pour argent comptant et se dire que ce dernier fait le bonheur. Oui oui des poncifs et croyez-moi il n’en manque pas dans ce roman où tous les personnages sont aussi stéréotypés que possible, une vraie galerie ! L’arriviste égotiste (le père), l’arriviste égoïste (la mère), l’irresponsable égocentrique (le fils)… Et le reste à l’avenant, même la victime n’arrive pas à être autre chose que pitoyable – ce qui dans ce contexte fait un peu grincer des dents.
Alors pourquoi ai-je aimé, vous dites-vous avec pertinence ? À cause de la seconde partie, le procès ! Car après nous avoir présenté – de façon peut-être un rien complaisante – ses déplaisants protagonistes sur fond de sexisme habituel, racisme ordinaire, antisémitisme de bon ton, dérive fascisante, obsession de l’apparence #twitermavie, peur de la vieillesse – qui n’est qu’un naufrage – et toute cette sorte de chose convenue, Karine Tuil nous convie au procès et là on entre dans le sec, le descriptif, le déballage organisé et méthodique d’un drame inter-incompréhensible ou chacun réclame que l’autre voit son point de vue sans jamais s’affranchir des limites de sa perception. C’est fascinant, prenant, méditant (je crois pas que ce mot puisse s’employer de cette manière mais enfin vous comprendrez l’intention). On assiste en spectateur – voire en juré – à l’exercice d’une justice impartiale, mesurée et bien plus humaine que ses justiciables (ce qui ne manque pas de sel) et la question du consentement ou plutôt de l’expression du consentement devient alors réellement le sujet. En tout cas pour la lectrice (en l’occurrence) car pour ce qui est des personnages, il ne m’a pas semblé qu’ils aient évolué d’un iota. Quant à l’autrice, visiblement fascinée par la complexité du monde, son épilogue technologique semble un peu contredire son impartialité perplexe ou me trompé-je ? Quoiqu’il en soit son livre brasse de multiple thématiques très actuelles – certes avec plus ou moins de subtilité – mais pose quelques bonnes questions et fournit ample matière à réflexion (dont celle-ci, vis-je bien finalement sur la même planète que ces gens ?). Questionnant !
Les choses humaines – Karine Tuil – Gallimard – 2019
PS : En cette période de prix littéraire, je vous offre un prix interallié doublé d’un Goncourt des lycéens. Qu’est-ce que vous dites de ça ? c’est pas tout les jours
PPS : quelqu’un pourrait me dire ce que vient faire la citation qui figure juste après la dédicace de ce roman et d’où elle vient ? je n’ai pas trouvé la source. On dirait du Fante non ?
Tu cherches quoi ? Semi-automatique ? Fusil à pompe ? Ça c’est un Beretta 92. Simple d’utilisation. Tu peux aussi prendre un Glock 17, génération 4, un 9 mm avec une crosse ergonomique, ça donne une prise en main ferme, faut bien l’emboîter, le pouce est là, on presse la détente avec la pulpe de l’index, attention, l’arme doit toujours être dans l’alignement du bras, on tire bras tendus, faut mécaniser la surprise au départ du coup, il reste plus qu’à approvisionner le chargeur, une fois que c’est fait, tu fixes la cible et quand tu l’as bien dans le viseur, tu appuies, ça part direct. Tiens, tu veux essayer ? Tu vois le gros clebs là ? Vas-y, bute-le.



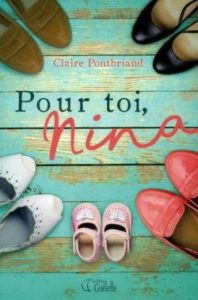 Jeanne est la maman de Charlotte qui est la maman d’Isa qui est celle d’Alice qui vient de mettre au monde – pour ses dix-neuf ans – la petite Nina. Or Jeanne s’inquiète pour Nina, insiste pour qu’Alice s’installe chez elle – ce qui convient pour un temps à la jeune femme. Mais que cache cette inquiétude diffuse et quelle est donc cette malédiction qui hante Jeanne ?
Jeanne est la maman de Charlotte qui est la maman d’Isa qui est celle d’Alice qui vient de mettre au monde – pour ses dix-neuf ans – la petite Nina. Or Jeanne s’inquiète pour Nina, insiste pour qu’Alice s’installe chez elle – ce qui convient pour un temps à la jeune femme. Mais que cache cette inquiétude diffuse et quelle est donc cette malédiction qui hante Jeanne ?
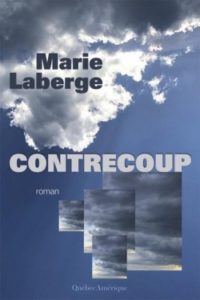 Un jour comme les autres, un homme a fait irruption dans un magasin et tiré sur les femmes présentes, trois sont mortes, une a survécu – mais dans quel état. Aussitôt arrêté, il se révèle être un de ces incel qui haïssent les femmes, toutes les femmes, les rendant responsables de tous leurs maux. Fin de l’histoire !? Non évidemment non, pour tous ceux qui touchaient de près ou de loin ces quatre femmes – parents, sœurs, amies, mais aussi cet homme devenu tueur, ce n’est que le début, le début d’une souffrance dont on ne voit pas la fin, d’une destruction du monde connu et peut-être – peut-être – d’une lente reconstruction…
Un jour comme les autres, un homme a fait irruption dans un magasin et tiré sur les femmes présentes, trois sont mortes, une a survécu – mais dans quel état. Aussitôt arrêté, il se révèle être un de ces incel qui haïssent les femmes, toutes les femmes, les rendant responsables de tous leurs maux. Fin de l’histoire !? Non évidemment non, pour tous ceux qui touchaient de près ou de loin ces quatre femmes – parents, sœurs, amies, mais aussi cet homme devenu tueur, ce n’est que le début, le début d’une souffrance dont on ne voit pas la fin, d’une destruction du monde connu et peut-être – peut-être – d’une lente reconstruction…
 Ce troisième opus des enquêtes de l’inspecteur Moralès nous entraine dans deux croisières hivernales bien différentes quoique concomitantes. (Si vous avez un autre mot, je suis preneuse). D’une part l’agente Lord, croisée dans la mariée de corail, embarque sur le Jean-Mathieu avec une escouade peu reluisante de chasseurs de loups marins (de phoques donc) pour surveiller les conditions d’abattage. Autant vous dire qu’elle n’est pas la bienvenue, ni en tant qu’agente de Pêches et Océans Canada, ni en tant que femme. De son côté Moralès a accepté de participer à une croisière caritative sur le Saint-Laurent avec étapes de ski de fond et fêtes tous les soirs, sans compter une psychologue judiciaire de ses amies qui aimerait fort l’impliquer dans sa dernière enquête. Un contraste absolu entre deux univers qui vont bien évidemment finir par se télescoper…
Ce troisième opus des enquêtes de l’inspecteur Moralès nous entraine dans deux croisières hivernales bien différentes quoique concomitantes. (Si vous avez un autre mot, je suis preneuse). D’une part l’agente Lord, croisée dans la mariée de corail, embarque sur le Jean-Mathieu avec une escouade peu reluisante de chasseurs de loups marins (de phoques donc) pour surveiller les conditions d’abattage. Autant vous dire qu’elle n’est pas la bienvenue, ni en tant qu’agente de Pêches et Océans Canada, ni en tant que femme. De son côté Moralès a accepté de participer à une croisière caritative sur le Saint-Laurent avec étapes de ski de fond et fêtes tous les soirs, sans compter une psychologue judiciaire de ses amies qui aimerait fort l’impliquer dans sa dernière enquête. Un contraste absolu entre deux univers qui vont bien évidemment finir par se télescoper…
 “Il y a en chacun de nous, un autre monde. La chose la plus importante est toujours celle qu’on ne connait pas.”
“Il y a en chacun de nous, un autre monde. La chose la plus importante est toujours celle qu’on ne connait pas.” PPS : Encore un roman qui m’a fait faire un tas de recherches sur l’internet : la maison-atelier bauhaus de San Angel, la maison bleue de Frida qui abrita Trotsky (aujourd’hui le musée Frida Kalho), le muralisme de Rivera, et ceci et cela…
PPS : Encore un roman qui m’a fait faire un tas de recherches sur l’internet : la maison-atelier bauhaus de San Angel, la maison bleue de Frida qui abrita Trotsky (aujourd’hui le musée Frida Kalho), le muralisme de Rivera, et ceci et cela… Il était une fois une famille de l’élite parisienne, lui journaliste célèbre et influent absorbé par son aura ; elle, intellectuelle engagée et essayiste connue de 27 ans sa cadette ; leur fil, Alexandre – 21 ans, surdoué, polytechnicien et étudiant à Stanford. Une famille idéale selon certains, mais évidemment fissurée de partout qui explose quand, dans le contexte des agressions de Cologne en 2016 et du #metoo triomphant sur les réseaux sociaux, le fils prodigue est accusé du viol le plus sordide qui soit, celui qui s’ignore…
Il était une fois une famille de l’élite parisienne, lui journaliste célèbre et influent absorbé par son aura ; elle, intellectuelle engagée et essayiste connue de 27 ans sa cadette ; leur fil, Alexandre – 21 ans, surdoué, polytechnicien et étudiant à Stanford. Une famille idéale selon certains, mais évidemment fissurée de partout qui explose quand, dans le contexte des agressions de Cologne en 2016 et du #metoo triomphant sur les réseaux sociaux, le fils prodigue est accusé du viol le plus sordide qui soit, celui qui s’ignore… Je suis une femme facile. Tout le monde vous le dira. Mais non pas dans ce sens-là bande de coquinous, simplement je suis facilement d’accord pour faire les choses – surtout avec mes ami.e.s, surtout avec
Je suis une femme facile. Tout le monde vous le dira. Mais non pas dans ce sens-là bande de coquinous, simplement je suis facilement d’accord pour faire les choses – surtout avec mes ami.e.s, surtout avec 
 PS : si un ou une véritable latiniste pouvait me dire si ma phrase latine est correcte ou mieux me la corriger, ce serait bien urbain de sa part. Mon latin est des plus rouillé. Bon je vous l’aurais bien traduite en vieux saxon mais pour quelle raison grand Tolkien ? d’autant que je ne le connais que par Beowulf interposé c’est à dire fort peu. bref bienvenu dans mon cerveau chaotique-zarbi !
PS : si un ou une véritable latiniste pouvait me dire si ma phrase latine est correcte ou mieux me la corriger, ce serait bien urbain de sa part. Mon latin est des plus rouillé. Bon je vous l’aurais bien traduite en vieux saxon mais pour quelle raison grand Tolkien ? d’autant que je ne le connais que par Beowulf interposé c’est à dire fort peu. bref bienvenu dans mon cerveau chaotique-zarbi !
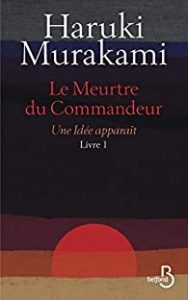 Un jeune peintre tokyoïte en pleine rupture sentimentale, sa femme a demandé le divorce sans la moindre petite dispute préalable, se retrouve gardien – en quelques sortes – d’une maison sur la montagne – ancien antre d’un célèbre peintre aujourd’hui atteint d’une de ces démences séniles qui terrorisent passé un certain âge. Reclus au milieu des meubles, des livres et des disques – classiquement occidentaux* – de l’ancien propriétaire notre esseulé cherche – assez mollement – a retrouver un sens à sa vie et à son art jusqu’à ce qu’une proposition trop belle lui soit faite et qu’une clochette retentisse au cœur de la nuit…
Un jeune peintre tokyoïte en pleine rupture sentimentale, sa femme a demandé le divorce sans la moindre petite dispute préalable, se retrouve gardien – en quelques sortes – d’une maison sur la montagne – ancien antre d’un célèbre peintre aujourd’hui atteint d’une de ces démences séniles qui terrorisent passé un certain âge. Reclus au milieu des meubles, des livres et des disques – classiquement occidentaux* – de l’ancien propriétaire notre esseulé cherche – assez mollement – a retrouver un sens à sa vie et à son art jusqu’à ce qu’une proposition trop belle lui soit faite et qu’une clochette retentisse au cœur de la nuit… Qu’est-ce qui peut bien nous faire embarquer dans un monument pareil ? (1050 pages si je ne m’abuse) (Parfois il me semble que plus Murakami Haruki vieillit plus ses romans sont longs ? Enfin n’en faisons pas une généralité, je ne suis pas une spécialiste du maitre.) Bref pourquoi donc ? Je pose la question et j’y réponds, parce que Murakami bien sûr. Au départ on s’y essaie mollement (un peu comme le protagoniste principal), un paragraphe, humph… on repose, on reprend plus tard même paragraphe humph on repose et puis un jour on franchit l’obstacle – aisément et sans effort – et à partir de là on a beau se demander ce qui nous accroche, on continue tranquillement, sans hâte inopportune, ni précipitation malvenue à s’égarer inexorablement dans l’imaginaire de l’auteur paradoxalement servi par une prose aussi pragmatique que factuelle. Et puis bon, quelle est cette étrange manie de répéter sans fin des propos déjà tenus ? Doit-on s’agacer ou se laisser bercer, grincer des dents ou saluer une écriture hypnotique voire introspective ? Et bien je ne saurais dire pour vous mais sur moi cela a incontestablement fonctionné et j’ai lu mes deux parpaings de 500 pages comme dans un rêve.
Qu’est-ce qui peut bien nous faire embarquer dans un monument pareil ? (1050 pages si je ne m’abuse) (Parfois il me semble que plus Murakami Haruki vieillit plus ses romans sont longs ? Enfin n’en faisons pas une généralité, je ne suis pas une spécialiste du maitre.) Bref pourquoi donc ? Je pose la question et j’y réponds, parce que Murakami bien sûr. Au départ on s’y essaie mollement (un peu comme le protagoniste principal), un paragraphe, humph… on repose, on reprend plus tard même paragraphe humph on repose et puis un jour on franchit l’obstacle – aisément et sans effort – et à partir de là on a beau se demander ce qui nous accroche, on continue tranquillement, sans hâte inopportune, ni précipitation malvenue à s’égarer inexorablement dans l’imaginaire de l’auteur paradoxalement servi par une prose aussi pragmatique que factuelle. Et puis bon, quelle est cette étrange manie de répéter sans fin des propos déjà tenus ? Doit-on s’agacer ou se laisser bercer, grincer des dents ou saluer une écriture hypnotique voire introspective ? Et bien je ne saurais dire pour vous mais sur moi cela a incontestablement fonctionné et j’ai lu mes deux parpaings de 500 pages comme dans un rêve.

 Thomas Chatterton Williams est journaliste, essayiste, écrivain. Il est aussi américain, marié à une française, père de deux enfants, diplômé de philosophie… bref Cet homme est plein de choses – comme nous tous – et accessoirement pour moi mais non pour lui, il est “noir”. Enfin sa mère est “blanche” et son père “noir”, ce qui fait de leur fils – selon la si pratique one-drop rule ou règle de la goutte unique – des “noirs”. Pourquoi pratique me direz-vous ? Mais parce qu’à l’époque ou la distinction passait entre libre et non-libre (doux euphémisme), cela permettait d’asservir – et donc de posséder – toute personne ayant une “goutte de sang noir” quelque soit son apparence (moui la nostalgie du passé ce sera sans moi). Toute sa vie donc, Thomas Chatterton Williams s’est vu, défini, considéré comme “noir” et a adopté tous les codes de la communauté à laquelle il se sentait appartenir. Et puis voilà, la vie, l’université, les voyages, l’amour et un jour dans une maternité parisienne, il devient père d’une petite fille blonde, à la peau crémeuse, aux yeux très bleus qui certes n’en descend pas moins d’esclaves arrachés à l’Afrique mais qui n’en a en rien l’apparence et qui est sans aucun doute la descendante de bien d’autres ancêtres. Tout comme son père !
Thomas Chatterton Williams est journaliste, essayiste, écrivain. Il est aussi américain, marié à une française, père de deux enfants, diplômé de philosophie… bref Cet homme est plein de choses – comme nous tous – et accessoirement pour moi mais non pour lui, il est “noir”. Enfin sa mère est “blanche” et son père “noir”, ce qui fait de leur fils – selon la si pratique one-drop rule ou règle de la goutte unique – des “noirs”. Pourquoi pratique me direz-vous ? Mais parce qu’à l’époque ou la distinction passait entre libre et non-libre (doux euphémisme), cela permettait d’asservir – et donc de posséder – toute personne ayant une “goutte de sang noir” quelque soit son apparence (moui la nostalgie du passé ce sera sans moi). Toute sa vie donc, Thomas Chatterton Williams s’est vu, défini, considéré comme “noir” et a adopté tous les codes de la communauté à laquelle il se sentait appartenir. Et puis voilà, la vie, l’université, les voyages, l’amour et un jour dans une maternité parisienne, il devient père d’une petite fille blonde, à la peau crémeuse, aux yeux très bleus qui certes n’en descend pas moins d’esclaves arrachés à l’Afrique mais qui n’en a en rien l’apparence et qui est sans aucun doute la descendante de bien d’autres ancêtres. Tout comme son père !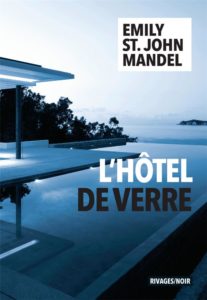 Tout au nord de l’île de Vancouver, au delà des routes, serti entre forêt et océan, se dresse un hôtel aux murs de verre, accessible uniquement par bateau. Seuls les très riches peuvent se permettre le luxe suprême de la déconnexion totale d’avec le monde ou du moins s’en donner l’illusion. Pourtant même ce havre recèle ses ombres et une nuit quelques mots apparaissent, gravés dans le verre : et si vous avaliez du verre brisé !
Tout au nord de l’île de Vancouver, au delà des routes, serti entre forêt et océan, se dresse un hôtel aux murs de verre, accessible uniquement par bateau. Seuls les très riches peuvent se permettre le luxe suprême de la déconnexion totale d’avec le monde ou du moins s’en donner l’illusion. Pourtant même ce havre recèle ses ombres et une nuit quelques mots apparaissent, gravés dans le verre : et si vous avaliez du verre brisé !
